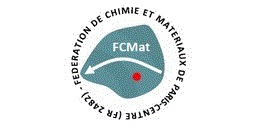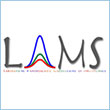LAMS (UMR 8220)

Laboratoire d'Archéologie Moléculaire et Structurale
Directeur : Philippe Walter
Directrice adjointe : Maguy Jaber
Dans cette page
Activités de recherche
Le Laboratoire d’Archéologie Moléculaire et Structurale est une unité mixte de recherche (CNRS et faculté des sciences de Sorbonne Université). Une trentaine de chercheurs, enseignant-chercheurs, ingénieurs et techniciens, doctorants et post-doctorants y mènent des recherches dans les domaines de la physico-chimie ainsi que des sciences humaines et sociales.
Les travaux du LAMS s’intéressent au rôle des matières et des techniques dans l’élaboration d’objets patrimoniaux.
Chimistes, physiciens, ingénieurs, archéologues, épigraphiste, philologue et historiens de l’art et des techniques développent une approche pluridisciplinaire pour comprendre le geste créatif en l’associant à des savoirs scientifiques et techniques.
Equipes et thématiques de recherche
Thèmes de recherche
- Les matériaux hybrides, leur synthèse et leur vieillissement (Maguy Jaber, Laurence de Viguerie)
- L’histoire et l’évolution des productions matérielles (Philippe Walter)
Avancées scientifiques, résultats marquants
Le LAMS dans les médias
ARTE Journal - analyse des tableaux de Brueghel l’Ancien
publié le 29 janvier 2018
Les mesures par spectrométrie de fluorescence des rayons X et imagerie hyperspectrale permettent d’étudier la pratique employée par Brueghel l’Ancien pour réaliser de ses tableaux sur toile : Le Misanthrope et La Parabole des aveugles.
ARTE Journal a suivi le laboratoire mobile du LAMS dans cette recherche, menée dans le cadre de la collaboration mise en place avec le Musée national de Capodimonte, à Naples.
Le reportage ici : https://www.arte.tv/fr/videos/080274-000-A/les-secrets-des-oeuvres-du-xvie-siecle/
Les recherches du LAMS sur la peinture étrusque à l’honneur sur la RAI
publié le 24 novembre 2017
Les recherches coordonnées par Matthias Alfled (LAMS) et Maria Cristina Gamberini (Université de Modène) et menées en collaboration avec la Soprintendenza en charge de la nécropole de Cerveteri (Italie) sont à l’honneur dans un reportage de la RAI "La fortuna degli Etruschi".
Voir en ligne ici : La fortuna degli Etruschi
(la partie sur les travaux d’analyse est entre les minutes 14 et 16 du documentaire.)
----------
Philippe Walter, Grand-Prix J.A. Le Bel de la Société chimique de France
publié le 7 septembre 2017
Le Conseil d’administration de la Société Chimique de France (SCF) réuni le 27 juin a décerné ses Grand Prix et Prix binationaux 2017.
Le Prix Joseph-Achille Le Bel a été décerné à Philippe Walter, directeur du laboratoire d’archéologie moléculaire et structurale (LAMS : UPMC/CNRS) « pour sa contribution remarquable au développement de méthodologies et d’outils de caractérisation analytique pour les sciences des matériaux du patrimoine. »
La Société Chimique de France promeut la chimie dans ses aspects scientifiques académiques et appliqués, éducatifs et sociétaux, depuis plus d’un siècle. Elle rassemble toutes les personnes quels que soient leurs secteurs d’activité (organismes publics ou privés) concernées par les sciences de la chimie et leurs applications.
Ecoles doctorales
Partenariats scientifiques
Nationaux
Un nouveau programme COST sur le bois
Programme CNRS-KIST sur les colorants (2013-2014)
Internationaux
PHC Franco-allemand Procope 2013-14
Programme ECOS-Sud - CONICYT (2010-2012)
The Representation of Colored Textiles in Victorian Painting (2013-2014)
Une nouvelle collaboration avec le Brésil coordonnée par Maguy Jaber
Principaux équipements
Le L.A.M.S. possède un laboratoire mobile et un laboratoire fixe.
Laboratoire mobile :
- un spectromètre visible
- un spectromètre IRTF
- un appareil de fluorescence X et de diffraction X
- une fluorescence X portable
- un microscope optique numérique
- un banc de mesures dendrochronologique
Laboratoire fixe :
- une loupe binoculaire
- un microscope avec fluorescence sous UV
- un laboratoire de préparation des échantillons
- un banc de mesures dendrochronologique
- un équipement de mesures archéomagnétiques
- un équipement de photogrammétrie
- un petit équipement de lasergrammétrie
Principales publications
Cyanobacterial formation of intracellular Ca-carbonates in undersaturated solutions
Nithavong Cam, Karim Benzerara, Thomas Georgelin, Maguy Jaber, Jean-François Lambert, et al.
Geobiology, Wiley, 2018, 16 (1), pp.49-61. (10.1111/gbi.12261).
The nature of ancient Egyptian copper-containing carbon inks is revealed by synchrotron radiation based X-ray microscopy
Thomas Christiansen, Marine Cotte, René Loredo-Portales, Poul Lindelof, Kell Mortensen, et al..
Scientific Reports, Nature Publishing Group, 2017, 7, pp.15346. (10.1038/s41598-017-15652-7).
Adsorption and photophysical properties of fluorescent dyes over montmorillonite and saponite modified by surfactant
Vidhyadevy Tangaraj, Jean-Marc Janot, Maguy Jaber, Mikhael Bechelany, Sebastien Balme.
Chemosphere, Elsevier, 2017, 184, pp.1355-1361. (10.1016/j.chemosphere.2017.06.126). (hal-01552808)
New archeointensity data from Novgorod (North-Western Russia) between c. 1100 and 1700 AD. Implications for the European intensity secular variation
Natalia Salnaia, Yves Gallet, Agnès Genevey, Ilya Antipov.
Physics of the Earth and Planetary Interiors, Elsevier, 2017, 269, pp.18 - 28. (10.1016/j.pepi.2017.05.012).
Rheology of white paints: How Van Gogh achieved his famous impasto
J. Salvant Plisson, L. De Viguerie, L. Tahroucht, M. Menu, G. Ducouret.
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Elsevier, 2014, 458, pp.134 - 141. (10.1016/j.colsurfa.2014.02.055).
Tutelle principale
SORBONNE UNIVERSITE
Autres tutelles
CNRS
Coordonnées
| Directeur WALTER Philippe 01.44.27.82.98 philippe.walter@sorbonne-universite.fr | Adresse physique Courriel du laboratoire Site web http://www.umr-lams.fr/ |
| Adresse postale LAMS (UMR 8220) Site Jussieu Tour 23-33 3e étage CC 225 4, place Jussieu 75252 Paris cedex 05 | Contact communication |
| Contact administratif JONCART Suzie 01.44.27.42.20 suzie.joncart@sorbonne-universite.fr |
Actualités
03.02.2021 - 28.02.2021
Etude d’œuvres d’art himalayennes (LAMS)
Recherche dirigée au LAMS par Laurence de Viguerie
La matérialité des œuvres peintes himalayennes a été peu considérée jusqu’à présent : ces œuvres bouddhistes, peintes par des moines ou des artistes, suivant des traditions millénaires sont extrêmement codifiées.
Nous nous intéressons à la fois aux peintures murales et à celles sur toile (‘thangkas’) : leur réalisation, les couleurs employées et leur signification mais aussi les pratiques artistiques liées à ces œuvres. Cette recherche allie deux aspects...01.02.2018 - 15.02.2018
ARTE Journal - Analyse des tableaux de Brueghel l’Ancien
ARTE Journal - Analyse des tableaux de Brueghel l’Ancien
Les mesures par spectrométrie de fluorescence des rayons X et imagerie hyperspectrale permettent d’étudier la pratique employée par Brueghel l’Ancien. ARTE Journal a suivi le laboratoire mobile du LAMS dans cette recherche...07.12.2017 - 20.12.2017
Récompense "L'Oeil et la pierre" primé en Italie
Le film "L’œil et la pierre" de Marcel Dalaise réalisateur CNRS Images et Muriel Labonnelie, archéologue spécialiste de la médecine gréco-romaine, au Laboratoire d’archéologie moléculaire et structurale récompensé en Italie par le jury du 28e festival international du film archéologique Paolo Or
04.07.2017 - 28.07.2017
Philippe Walter remporte le prix Joseph-Achille Le Bell (SFC)
Le Prix Joseph-Achille Le Bel a été décerné à Philippe Walter du laboratoire d’archéologie moléculaire et structurale (LAMS: UPMC/CNRS) « pour sa contribution remarquable au développement de méthodologies et d’outils de caractérisation analytique pour les sciences des matériaux du patrimoine. »
18.05.2017 - 31.05.2017
Maguy Jaber nommée à l’Institut Universitaire de France
Une fois de plus, la Chimie de l’UPMC est à l’honneur, avec la nomination de Maguy JABER, Professeure au LAMS ( Laboratoire d’Archéologie Moléculaire et Structurale ).
...
14.01.2016 - 15.01.2016
Colloque international "Le teint de Phrynè. Thérapeutique et cosmétique dans l’Antiquité"
Organisé par Muriel Labonnelie et Véronique Boudon-Millot, dans le cadre du programme de recherche POLYRE soutenu par Sorbonne Universités, ce colloque transdisciplinaire réunira des archéologues, des historiens, des philologues et des chimistes.
Dans cette rubrique
Contact
Direction :
Xavier Carrier (xavier.carrier @ upmc.fr)
Secrétariat, administration et réservation des salles de réunion :
X
Coordonnées :
FSI - FCMAT FR2482
Tour 44/43
3ème étage
Pièce 320
4 place Jussieu
75252 Paris cedex 05
Tél : 01 44 27 31 89
Webmaster :
Fernande SARRAZIN (fernande.sarrazin @ upmc.fr)
--------------
--------------
La FCMat en chiffres
- 6 laboratoires
- 160 chercheurs et enseignants-chercheurs
- 74 BIATSS et ITA
A voir
L'UFR DE CHIMIE
SCIENCE SORBONNE UNIVERSITE